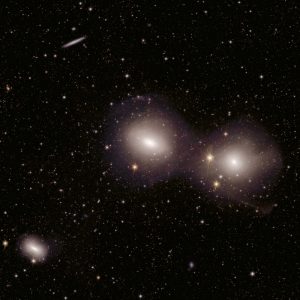Programme
Lundi 10 juin – 17:00 / Conférence musicale et concert conférencé sur les effets et méfaits des politiques migratoires. Marie-Laurence Flahaux (Démographe, IRD-LPED) et Mustapha Lakhdari (conteur, musicien)
Hyperion – 2bis avenue du Maréchal Foch, 13004 Marseille
Lundi 17 juin 2024 – 14:00 / Film sous les arbres – “Quand murissent les clémentines”. La projection et les échanges avec Lama Kabbanji, réalisatrice et chercheure au LPED, sera suivi d’un gouter.
Campus Saint Charles, espace Turbulence, 13003 Marseille
Vendredi 21 juin 2024 – 9:00 / Visite conférencée pour découvrir les papillons et les oiseaux en ville. Magali Deschamps-Cottin, Christine Robles et Pascal Carlier ferons découvrir le PUP, les papillons et les oiseaux en ville.
Parc Urbain des Papillons, 13014 Marseille
Jeudi 4 juillet 2024 – 17:00 / Les résistances aux antibiotiques et la science : quand les éleveurs africains sont pointés du doigt. Conférence sur le toit de la Cité de l’agriculture avec Anastasia Seferiadis et Carine Baxerres.
Cité de l’agriculture, 13001 Marseille
Jeudi 11 juillet 2024 – 9h:00 / Palabre sous les arbres : la démographie africaine est-elle coupable de tout ? Vous voulez tout savoir (ou presque) sur la démographie africaine ? les démographes de l’IRD vous invitent à palabrer transition démographique, migration, changements environnementaux…
Square Labadié, 13001 Marseille