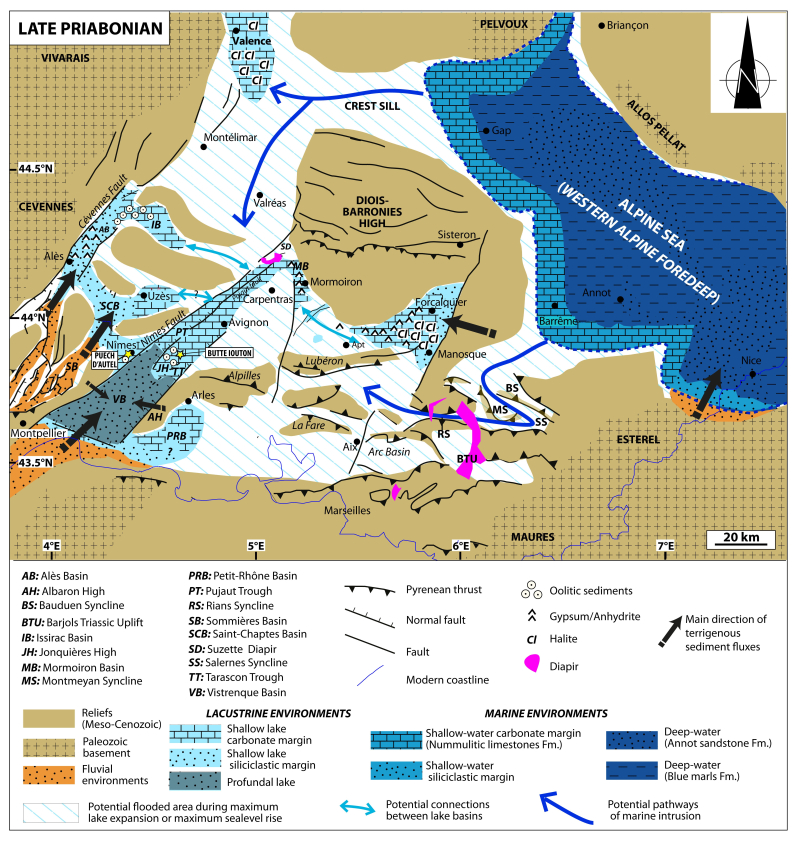La migration des Homo erectus en Asie du Sud-Est au Pléistocène précoce est un élément essentiel à notre compréhension de l’évolution du genre Homo. Or, la restitution d’une histoire plausible bute à la fois sur une chronologie controversée et sur la connaissance trop parcellaire de leur environnement en rapide évolution. Il s’agit donc de déterminer la période de dispersion des H. erectus en Asie du Sud-Est, de reconstruire leur environnement à cette période, et de déterminer leurs trajectoires migratoires. Une équipe de scientifiques, dont certains CNRS-INSU (voir encadré) a mené un travail selon une méthode inédite de reconstruction globale qui permet de retracer la chronologie du peuplement de l’Asie du Sud-Est.
L’étude comporte trois volets : (1) Tout d’abord, en utilisant la méthode de datation par nucléides cosmogéniques (10Be et 26Al) pour la première fois pour l’Homme de Java, l’équipe a constaté que les H. erectus se sont déployés à Sangiran (Java) vers 1,8 Ma. Cet âge étonnamment ancien, proche de celui des plus anciens H. erectus chinois ou géorgiens, impose de réviser les modalités de circulations en Asie continentale. (2) Ensuite, en adossant des méthodes numériques de reconstruction des paysages à un faisceau d’observations géomorphologiques, le contexte physiographique régional a été établi. Celui-ci était fondamentalement différent de l’Actuel, puisqu’il proposait des conditions continentales hospitalières sur l’ensemble de la Sonde (la plateforme continentale semi-inondée couvrant l’ouest de l’Asie du Sud-Est) tandis que l’île de Java émergeait tout juste de l’océan et se connectait à la Sonde. (3) Enfin, en appliquant des simulations numériques de déplacements écologiques aux hominidés, l’équipe a pu établir de façon inédite les chemins de migrations et lieux d’accumulation les plus probables des H. erectus au travers de ces paysages reconstruits.
Il ressort que la dispersion des H. erectus au travers de la Sonde s’est établie sur des dizaines ou centaines de milliers d’années, un temps suffisamment long pour que les changements dans leur environnement physique -climatique ou physiographique- aient influé sur les processus migratoires et comportementaux des H. erectus. Cette nouvelle approche offre un nouveau cadre pour évaluer l’évolution des hominidés.
Voir en ligne : L’article sur le site de l’INSU