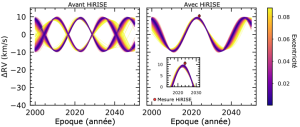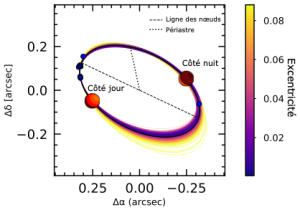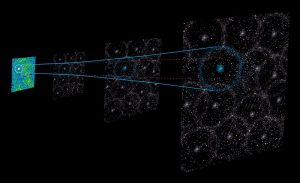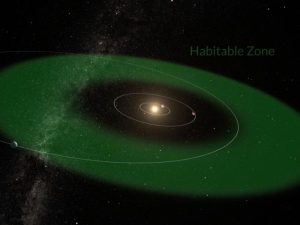Un métabolisme ultra-efficace révélé par imagerie cellulaire
Menée par des chercheurs du CNRS Terre & Univers en collaboration avec des équipes européennes, cette étude s’est appuyée sur des techniques d’imagerie cellulaire pour analyser la composition en carbone, azote et phosphore des algues glaciaires. En mesurant leurs taux d’assimilation des nutriments, l’étude a montré que ces algues accumulent du phosphore intracellulaire et présentent des ratios carbone/nutriments exceptionnellement élevés. Ces caractéristiques indiquent une stratégie physiologique parfaitement bien adaptée aux environnements pauvres en nutriments des surfaces glaciaires.

Des conséquences directes sur la fonte des glaces
La calotte glaciaire du Groenland est actuellement la principale source de l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale. Au cours de la dernière décennie, des études ont montré que les floraisons algales sur sa marge occidentale réduisent l’albédo de la glace, entrainant une augmentation moyenne de 13 % des taux de fonte. L’étude met en lumière la capacité des Ancylonema spp à prospérer dans des conditions pauvres en nutriments, ce qui pourrait favoriser leur expansion avec le réchauffement climatique.

Une stratégie de survie hors norme pour un environnement extrême
Cette nouvelle étude met en évidence la manière dont ces micro-organismes particulièrement résilients optimisent l’absorption des nutriments, assurant leur survie et leur développement malgré les conditions oligotrophes de la glace. Ces découvertes suggèrent que leur croissance n’est pas freinée par la disponibilité des maconutriments, ce qui signifie que toute nouvelle surface de glace exposée pourrait potentiellement être colonisée. Ce phénomène contribue à accentuer la fonte des glaciers et, par conséquent, l’élevation du niveau de la mer en réponse au réchauffement climatique.
Cette étude a été dirigée par Dr. Laura Halbach (Max Planck Institute for Marine Microbiology, Brême) en collaboration avec des scientifiques européens, et soutenue par le Conseil Européen de la Recherche (ERC) dans le cadre du projet Deep Purple.
Des microalgues qui accélèrent la fonte des glaces
11.04.2025
Interview de Rey Mourot et James Bradley, chercheurs CNRS affectés au MIO Institut Méditerranéen d’Océanologie. Au Groenland, des microalgues pigmentées glaciaires se propagent sans apport externe de nutriments, intensifiant ainsi l’assombrissement de la glace et accélérant sa fonte.