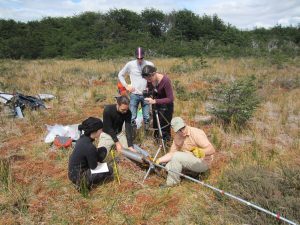L’une des capacités clés du JWST est sa capacité à observer les galaxies très lointaines, et ainsi à sonder l’histoire précoce de l’univers. Une équipe internationale d’astronomes, menée par Callum Witten (Université de Cambridge) et Nicolas Laporte (Aix-Marseille Université), a mis à profit la capacité exceptionnelle du JWST pour résoudre un mystère de longue date en astronomie.
Les galaxies les plus anciennes étaient des sites de formation d’étoiles vigoureuse et active, et étaient donc des sources riches d’émission Lyman-α de l’hydrogène. Cependant, pendant l’époque de la réionisation, une immense quantité de gaz d’hydrogène neutre entourait ces zones de formation d’étoiles actives. De plus, l’espace entre les galaxies était rempli de plus de ce gaz neutre qu’aujourd’hui. Ce gaz peut absorber et diffuser très efficacement Lyman-α, de sorte que les astronomes ont depuis longtemps prédit que l’émission Lyman-α libérée dans
l’univers très primitif ne devrait pas être observable aujourd’hui.
Cependant, cette théorie n’a pas toujours résisté à l’observation, car des exemples d’émission Lyman-α très précoce ont déjà été observés. Cela a présenté un mystère : comment se fait-il que cette émission d’hydrogène, qui aurait dû depuis longtemps être absorbée ou diffusée, soit observée?
L’apport de cette nouvelle étude est dû à l’extraordinaire combinaison de résolution angulaire et de sensibilité du JWST. Les observations avec l’instrument NIRCam ont permis de résoudre des galaxies plus petites et plus faibles qui entourent les galaxies lumineuses à partir desquelles l’émission d’hydrogène « inexplicable » avait été détectée. En d’autres termes, l’environnement de ces galaxies semble être un endroit beaucoup plus fréquenté que nous ne le pensions auparavant, rempli de petites galaxies faibles. Ces galaxies plus petites interagissent et fusionnent les unes avec les autres (voir le figure ci-dessous), et JWST a donc révélé que les fusions de galaxies jouent un rôle important dans l’explication de l’émission Lyman-α des premières galaxies.
L’équipe a ensuite utilisé des simulations informatiques pour explorer les processus physiques qui pourraient expliquer leurs résultats. Ils ont découvert que l’accumulation rapide de masse stellaire par le biais des fusions de galaxies provoque à la fois une forte émission d’hydrogène et facilite l’échappement de cette radiation par des canaux dégagés du gaz neutre abondant. Ainsi, le taux élevé de fusion des galaxies plus petites non observées précédemment présente une solution convaincante au mystère de longue date de l’émission d’hydrogène précoce « inexplicable ». L’équipe prévoit des observations de suivi avec des galaxies à divers stades de fusion, afin de continuer à développer leur compréhension de la manière dont l’émission
d’hydrogène est éjectée de ces systèmes en évolution. Cela leur permettra d’améliorer notre compréhension de l’évolution des galaxies.
Ces découvertes ont été publiées dans Nature Astronomy : https://www.nature.com/articles/s41550-023-02179-3