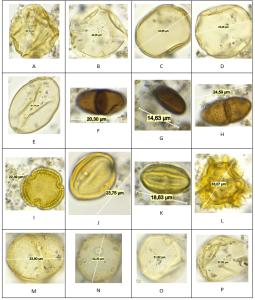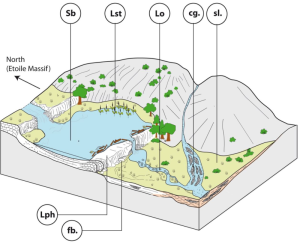Le changement climatique exerce une pression croissante sur les écosystèmes marins, affectant notamment les foraminifères planctoniques, des micro-organismes essentiels au cycle du carbone océanique. Une étude récente, menée par le centre de recherche CEREGE à Aix-en-Provence (Université Aix-Marseille, CNRS, IRD & INRAE), la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) au sein du Centre de Synthèse et d’Analyse sur la Biodiversité (CESAB) à Montpellier, ainsi que l’Institut Max Planck de Chimie à Mayence (Allemagne), révèle que les populations de foraminifères diminuent à un rythme sans précédent en raison du réchauffement et de l’acidification des océans. Les niveaux élevés de CO₂, responsables de l’acidification des eaux, compliquent la formation des coquilles de ces organismes unicellulaires, menaçant leur survie. Ces sentinelles climatiques migrent vers des eaux plus fraîches pour tenter de s’adapter, mais les changements environnementaux se produisent plus rapidement qu’elles ne peuvent s’y ajuster.
L’équipe internationale, composée de scientifiques français, allemands, néerlandais, japonais et espagnols, a analysé près de 200 000 échantillons de foraminifères collectés depuis 1910 afin d’étudier leur réponse au changement climatique. L’étude, récemment publiée dans la revue Nature, montre que ces espèces migrent vers les pôles, en quête d’eaux moins chaudes, à un rythme pouvant atteindre 10 kilomètres par an. En examinant des profils verticaux, les chercheurs ont également constaté que certaines espèces se déplacent plus en profondeur dans l’océan pour échapper au réchauffement des températures de surface. Malgré ces déplacements, les populations de foraminifères ont diminué de 25 % au cours des 80 dernières années. Les espèces tropicales sont les plus touchées, car le réchauffement intense dans ces régions perturbe probablement leurs cycles reproductifs, entraînant un déclin majeur.
Les chercheurs estiment que d’ici la fin du XXIe siècle, de nombreuses espèces de foraminifères planctoniques pourraient être confrontées à des conditions environnementales sans précédent, dépassant potentiellement leurs seuils de survie. Cela pourrait conduire à de nouvelles extinctions dans les régions tropicales, avec des répercussions conséquentes sur les écosystèmes marins et le stockage du carbone. L’augmentation des niveaux de CO₂ dans l’océan, limite la formation de carbonate de calcium, un composant essentiel pour la construction des coquilles des foraminifères. La production réduite de coquilles de foraminifères planctoniques pourrait ainsi réduire la quantité de carbone piégée dans les fonds marins. Néanmoins, certaines espèces pourraient migrer vers les régions polaires à la recherche d’eaux plus fraîches, favorables à leur développement.
Des questions clés subsistent quant à la manière dont ces espèces s’adapteront à une acidification extrême et à des environnements en rapide évolution. Cela met en lumière la nécessité de recherches supplémentaires sur leurs stratégies d’adaptation et les efforts de conservation pour protéger les écosystèmes marins face au changement climatique en cours.
Cette recherche a été financée par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) au sein du Centre de Synthèse et d’Analyse sur la Biodiversité (CESAB) et cofinancée par l’Institut Max Planck de Chimie (MPIC) à Mayence, en Allemagne, le programme CNRS-INSU LEFE et l’Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université – A*MIDEX.